M. Bernhard Blumenkranz, sous le patronage de M. Pierre Courcelle
Notre documentation sur la présence des Juifs en France aux premiers siècles accuse une lacune énorme, de presque quatre siècles et demi.
Les premiers témoignages sur une présence juive en France sont dus à une source parfaitement sûre, les Antiquités Judaïques de Flavius Josèphe. Encore ne concernent-ils point une implantation volontaire en groupe, mais des séjours forcés imposés à des relégués princiers de la famille royale hérodienne.
Le premier à être frappé d’une telle mesure est Archelaus, ethnarque de Judée, qui, dans la dixième année de son règne, l’an 6 de l’ère commune, est relégué à Vienne par Auguste. C’est là qu’il meurt vers l’an 16.
Indice de plus qu’il s’agit d’une présence isolée, au meilleur cas en compagnie de quelques serviteurs : son corps semble avoir été transféré en Palestine pour l’enterrement.
Dans son De situ et nominibus locorum hebraicorum compilé ou plutôt traduit en 380, saint Jérôme prétend de toute manière avoir vu sa tombe près de Bethléem.
Le frère cadet d’Archelaiis, Hérode Antipas, tétrarque de Galilée et de Pérée, est frappé d’un sort semblable en 39 : Caligula l’exile à Lugdunum en Gaule ; sans aucun doute s’agit-il de Lyon et non pas du Lugdunum Convenarum, la localité actuelle de Saint- Bertrand, sur la pente des Pyrénées. Sa femme Hérodiade l’accompagne dans son lieu de relégation. Hérode Antipas meurt également en exil.
Désormais ce sera le vide documentaire jusqu’en 465.
Alors, le concile de Vannes, en Bretagne, édictera un canon pour interdire aux clercs de participer à des repas en commun avec des Juifs ; s’il met en garde contre des rapports trop étroits avec eux, c’est qu’il en existe déjà en nombre appréciable.
Et en effet, peu d’années plus tard, Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, recommandera un Juif fraîchement converti, Promotus, à un des pères de ce concile de Vannes, Nunechius, évêque de Nantes.
Trois autres lettres des environs de 470 toujours de Sidoine Apollinaire nous font connaître d’autres Juifs encore. Et à partir de maintenant les témoignages de toute sorte vont aller en se multipliant, grâce à Césaire d’Arles, grâce aux Canons conciliaires comme ceux d’Agde en 506, du 1er concile d’Orléans en 511, de celui de Valence en 524, du 2e concile d’Orléans en 533, grâce aux lois barbares comme celle des Burgondes en 502, et je m’abstiens de mentionner, dans cette rapide énumération, des sources postérieures au premier tiers du vie siècle.
Vide documentaire, ai-je dit, pendant presque quatre siècles et demi, de 39 à 465 : je veux dire par cela :
Absence complète de tout témoignage contemporain et qui seul peut satisfaire nos exigences critiques d’aujourd’hui. J’ai, en effet, refusé d’accepter comme source valable une poésie de Paul Diacre qui, à plus de quatre siècles de distance, affirme une origine juive pour Siméon, le septième évêque de Metz, vers 350.
Je n’ai pas accordé davantage de valeur documentaire au témoignage de Venance Fortunat qui, dans sa Vita de saint Hilaire de Poitiers, à la fin du vie siècle, donc à plus de deux cents ans après lui, affirme qu’il avait évité tout contact avec les Juifs jusqu’à refuser de leur rendre le bonjour quand ils le saluaient.
Malgré la distance quelque peu raccourcie qui sépare le témoin du fait allégué, je ne me suis pas davantage départi de ma méfiance quand j’ai trouvé un nommé Ravennio ou Reverentio, au vie siècle, affirmer que les obsèques d’Hilaire d’Arles, en 459, étaient également suivies par de nombreux Juifs qui chantaient en hébreu.
Bien au contraire : ma méfiance à ce propos était d’autant plus vive que nous avons affaire ici, avec la description de la participation juive au deuil d’un saint personnage, à un cliché littéraire parfaitement établi au VIe siècle dans la littérature hagiographique.
Enfin, personne aujourd’hui n’oserait plus se référer à Dom Polycarpe de La Rivière qui, au XVIIe siècle, à presque treize siècles de distance du fait allégué, nous apprend qu’en 390 les Juifs d’Avignon avaient participé à une révolte contre l’évêque.
COMPTES RENDUS DE L’ACADEMIE DES INSCRIPTIONS
Si nous devions continuer à ne disposer que de la documentation dont je viens de faire état, nous serions obligés à ne placer les débuts d’une présence consistante des Juifs en France qu’à l’extrême fin du second tiers du Ve siècle.
Fort heureusement, là où les textes d’une authenticité indiscutable font défaut, des preuves archéologiques viennent suppléer aux lacunes de notre information.
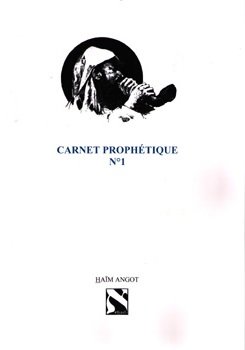 Voici, tout d’abord, une lampe à huile (fig. 1) découverte par M. Jean Charmasson en été 1963 au cours des fouilles qu’il dirigeait sur l’oppidum de Lombren, un site sur la rive droite du Rhône et à égale distance — 3.000 mètres — entre le fleuve et la localité de Bagnols-sur-Cèze.
Voici, tout d’abord, une lampe à huile (fig. 1) découverte par M. Jean Charmasson en été 1963 au cours des fouilles qu’il dirigeait sur l’oppidum de Lombren, un site sur la rive droite du Rhône et à égale distance — 3.000 mètres — entre le fleuve et la localité de Bagnols-sur-Cèze.
Grâce à la courtoisie de l’inventeur, j’ai été aussi amplement informé sur cet objet que j’ai pu le désirer. La cassure du disque — et qui laisse pourtant reconnaître les deux trous d’aération au tiers inférieur — remonte à l’antiquité ; elle n’a pas empêché le propriétaire de cette lampe de s’en servir : en effet, le bec est fortement noirci par un dépôt de combustion. La terre cuite rosé de la lampe avait été recouverte d’un vernis orange de mauvaise qualité dont il ne reste plus que quelques traces. Les dimensions actuelles de la pièce sont de 35 millimètres de hauteur, 75 millimètres de largeur et de 110 de longueur. La queue de préhension est également un peu cassée. Nous avons ici une lampe piriforme à large canal de jonction entre le bec arrondi et le disque central ; tout ceci en fait un spécimen des premières lampes dites chrétiennes, c’est-à-dire qui date de la fin du ive-début du ve siècle. Les autres produits des fouilles du site de Lombren ne font que confirmer cette datation.
Cette lampe est conservée par M. Charmasson, à Bagnols-sur-Cèze. Son inventeur en a donné quelques brefs renseignements dans son compte rendu des fouilles, L’oppidum bas-rhodanien de Lombren…, dans Cahiers rhodaniens, IX, 1962 (paru en 1965), p. 74.
Un spécimen des premières lampes dites chrétiennes, ai-je dit à l’instant.mIl va de soi que cela s’entend uniquement de la forme, car nous avons affaire ici à une lampe authentiquement juive.
Sur le bord, on reconnaît dans la couronne de feuillage en réalité deux branches de palmier ; et elles entourent un motif central dont, malgré la cassure du disque, suffisamment d’éléments subsistent pour permettre sa reconstitution incontestable (fig. 2): un chandelier à sept branches posé sur un trépied ; celui-ci est légèrement incurvé, tandis que le dessin du haut du chandelier est extrêmement fruste au point de rappeler certains graffiti très schématisés. Les branches droites, peu rapprochées, sont pliées à l’angle droit pour rejoindre la tige centrale qui est légèrement plus forte.
Face à chaque lampe à huile, la question se pose de savoir si nous avons affaire à une production locale ou bien à un élément du commerce d’importation.
Ici, à Lombren, la réponse est aisée. C’est un produit local au plein sens du terme ; notre lampe a été trouvée dans une cabane qui avait servi d’atelier de potier.
Un autre problème, celui de la cohabitation avec d’autres cultes, trouve également une réponse nette à Lombren : aucune autre trace de vie religieuse n’y a été trouvée que précisément notre lampe juive.
A la lumière de la découverte de cette lampe, un objet auquel je m’étais passablement intéressé depuis un bon nombre d’années me semble avoir trouvé sa pleine signification (fig. 3).
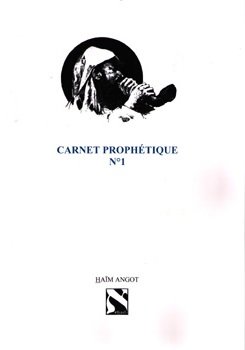 Nous avons ici une matrice en bronze de 35 sur 25 millimètres ; tout le dessin est en relief, ce qui fournit donc des empreintes en creux. Cette matrice fait partie des collections du Musée Calvet d’Avignon.
Nous avons ici une matrice en bronze de 35 sur 25 millimètres ; tout le dessin est en relief, ce qui fournit donc des empreintes en creux. Cette matrice fait partie des collections du Musée Calvet d’Avignon.
M. Georges de Loye, conservateur en chef du Musée, à qui je dois aussi bien la photo de la matrice qu’une empreinte, a renouvelé sur ma demande des recherches sur l’origine de cet objet, mais sans plus de succès qu’auparavant. Il avait fait partie des collections du fondateur du Musée, m’apprend-il, mais le Dr Calvet n’avait pas laissé à ce propos le moindre renseignement d’origine, de provenance ou de date d’acquisition. Mais nous savons par ailleurs que sa collection a été composée principalement par les produits des découvertes locales et rien ne nous empêche d’accorder, ne serait-ce qu’en tant qu’hypothèse de travail, une origine également locale à cette matrice.
Garrucci, dans sa Storia delVArte cristiana est, à ma connaissance, le premier a l’avoir relevée ; de là, elle a été reprise par le Père Frey, dans son Corpus inscriptionum iudaicarum. A l’unisson, ces auteurs ont vu ici un sceau individuel d’un nommé Januarius.
J’ai parfaitement conscience de la piètre valeur d’un argument e silentio. Qu’il me soit pourtant permis d’en user ici, puisqu’aussi bien l’anthroponymie juive des premiers siècles a un registre extrêmement réduit et que ce sont généralement toujours les mêmes noms qui se rencontrent : or, Januarius ne posséderait que cette seule et unique attestation.
Sans accorder davantage de valeur au jugement d’autorité, j’aime quand même signaler que le savant qui en dernier lieu s’est intéressé à cet objet, Goodenough, dans son monumental ouvrage Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, n’est pas davantage satisfait de l’interprétation Januarius.
Retournons à l’objet pour essayer d’y voir clair. Nous reconnaissons aisément ici un chandelier juif; il est. vrai qu’il comporte non pas sept, mais cinq branches. La réduction du nombre des branches procède d’un scrupule religieux exprimé dans le passage talmudique suivant : « II ne faut pas se faire une maison qui serait comme le temple, ou une table comme la table sacrée du temple, ou une ménorah (chandelier à sept branches) comme celui du temple… de quelque matériau qu’elle soit ».
Pour éviter de telles imitations, est-il dit, on peut faire une ménorah de cinq, six ou huit branches, mais non pas de sept.
La qualité juive de notre chandelier, si quelque doute subsistait, est également confirmée par les deux objets au-dessus du trépied de support :ce sont des fruits de cédrat qui jouent un rôle liturgique lors de la fête des cabanes en automne. Les branches du chandelier sont légèrement incurvées ; une espèce de nervure rappelle d’une manière saisissante l’élément végétal auquel on a tenté de rattacher le symbole du chandelier : le palmier.
Reste l’inscription, qu’il faut, bien sûr, inverser gauche droite car nous avons affaire ici à une matrice.
Je propose pourtant de voir ici une simulation de l’écriture hébraïque, pour l’orientation de la lecture il s’entend, et de lire alors de droite à gauche en même temps que de haut en bas le mot avin, c’est-à-dire avinionensis, l’Avignonnais.
Bien sûr, la ville d’Avignon et ses habitants s’appelaient dans l’antiquité Avennio et Avennionenses ; au moins trois inscriptions latines ont conservé cette forme. Mais nous trouvons également, dans des sources littéraires d’une très haute époque, la forme Avinnio et Avinnionenses.
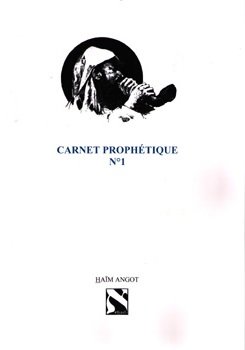 Face à l’écriture, il convient de se prononcer sur la date qui, au jugement de M. Robert Marichal qui a bien voulu me donner son avis, ne saurait être postérieure au ive siècle.
Face à l’écriture, il convient de se prononcer sur la date qui, au jugement de M. Robert Marichal qui a bien voulu me donner son avis, ne saurait être postérieure au ive siècle.
Par cette date, notre objet se rapproche d’une production assez répandue, à savoir des amulettes, et dont voici un exemple très similaire (fig. 4).
Mais au contraire de la pièce que voici qui est conservée au British Muséum et qui est destinée à un seul propriétaire, notre matrice de tout à l’heure est destinée à l’ensemble des Juifs d’Avignon.
Si mon interprétation peut être retenue, et parce que nous avons affaire à une matrice dont la fonction est de multiplier ses produits, nous nous trouverions en face d’une espèce de plaque d’identification servant peut-être à prouver l’appartenance juive de son porteur.
Par ailleurs, le chandelier juif est devenu en Gaule du IVe siècle, un élément décoratif assez répandu au point de perdre quelquefois sa signification religieuse juive.
Il se retrouve sur des céramiques gallo-romaines décorées à la molette, si soigneusement inventoriées par Chenet dans sa publication de 1941. Sur le motif présenté par le numéro 170 de l’inventaire de Chenet, le trépied de support est bien reconnaissable. Sur le motif voisin, ce savant a voulu reconnaître un autre élément du Temple de Jérusalem : la table avec les pains de proposition. J’hésite d’autant moins à accepter cette suggestion que, dans le texte biblique, le précepte sur la table avec les pains de proposition et celui sur le chandelier sont parfaitement voisins (Ex. 25, 23-30 et 31-40).
Il me semble même que le chandelier se retrouve sur un certain nombre d’autres molettes employées au IVe siècle et toujours inventoriées, par Chenet dans de très nombreux exemples de céramiques sigillées.
En continuant à remonter dans le temps, c’est au début du IVe siècle que j’ai tendance à placer la bague bien connue d’Aster trouvée en 1854 à Bordeaux et qui avait fait partie de la collection d’Alexis de Chasteigner (fig. 5).
Ajoutons encore que la bague a disparu depuis la mort de ce collectionneur ; nous ne disposons donc, pour en juger, que des dessins et des photographies présentés par Camille Jullian dans son ouvrage sur Les inscriptions romaines de Bordeaux.
Si, en opposition à tous les savants qui de près ou de loin se sont intéressés à cette bague et qui tous, jusqu’à M. Michel Fleury en dernier lieu, la datent du VIe siècle.
Si de mon côté, dis-je, je propose une date beaucoup plus ancienne, c’est pour la raison suivante : de Chasteigner lui-même avait assisté à la découverte de l’objet et avait signalé, dans son compte rendu très détaillé, que les seuls objets découverts dans la même couche étaient des bronzes de Dioclétien, ce qui nous amène précisément au début du IVe siècle.
Ce n’est point là une bague sigillaire, mais plutôt ce qu’il faut appeler une bague d’identification.
Le monogramme peut aussi bien signifier le nom féminin d’Aster que celui masculin d’Asterius. Relevons en passant, encore qu’il ne faille point en exagérer la valeur, l’orientation de droite à gauche qui rappelle ce que j’ai proposé d’appeler une écriture hébraïque simulée. Les lettres aster sont répétées sur le socle du chaton de manière à éviter toute erreur de lecture.
C’est là un procédé qui se retrouve ailleurs et qui a été signalé par Deloche dans son ouvrage sur les anneaux. Mais là où le propriétaire de notre bague se distingue, c’est dans l’insistance qu’il apporte pour se faire reconnaître comme Juif ; la répétition du nom autour du socle est terminée par un dessin du chandelier à sept branches.
Et en plus grand format encore, ce chandelier figure également sur l’anneau, des deux côtés et en prolongation du chaton.
Un curieux détail reste encore à noter : notre bague a été trouvée à l’angle de l’actuelle rue Cheverus qui portait, tout au long du Moyen Âge, le nom de rue Judaïque parce qu’elle était un des centres principaux de l’habitat juif dans Bordeaux.
Notre bague nous est témoin d’une exceptionnelle continuité de l’implantation juive dans la cité.
Sans avoir trop à nous éloigner dans l’espace : à une centaine de kilomètres au Nord de Bordeaux, à Salignac-de-Pons (Charente- Maritime), nous rencontrons une lampe juive du IIIe siècle (fig. 6).
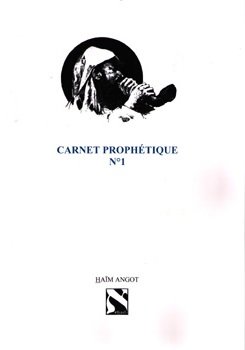 Elle a été découverte au XIXe siècle au Port-du-Lys, lieu-dit de Salignac-de-Pons, et avait été acquise par le collectionneur Gabriel Cor à Cognac qui l’avait léguée en 1904, avec l’ensemble de sa très importante collection, au Musée de sa ville.
Elle a été découverte au XIXe siècle au Port-du-Lys, lieu-dit de Salignac-de-Pons, et avait été acquise par le collectionneur Gabriel Cor à Cognac qui l’avait léguée en 1904, avec l’ensemble de sa très importante collection, au Musée de sa ville.
C’est grâce à une enquête systématique menée à travers les musées et collections publiques en France, grâce surtout à la très grande courtoisie de Mlle Reverchon, Conservateur du Musée de Cognac, que j’ai découvert cette très belle pièce dont il faut franchement s’étonner qu’elle n’ait jamais fait l’objet jusqu’ici d’une publication.
Notre lampe en terre cuite rouge à pour dimensions actuelles 25 sur 90 sur 68 millimètres ; elle est légèrement endommagée là où se plaçait l’anse ou la queue de préhension. Le bec arrondi est légèrement allongé et séparé par trois cercles du disque central. Fig. 6. Lampe juive du IIIe siècle
Le chandelier à sept branches comporte sur la tige centrale un jeu de dix ronds, sur les autres branches des stries horizontales ; nous avons ici la réunion de deux éléments décoratifs qui président souvent, mais l’un ou l’autre seulement, à la présentation des chandeliers.
Chaque branche se termine en deux courtes stries longitudinales qui sans doute doivent rappeler les flammèches du chandelier allumé ; je ne connais qu’un autre exemple pour ce procédé. Les deux trous d’aération sont placés entre le trépied et le corps de la lampe sans nuire à l’harmonie de l’ensemble.
De la barre horizontale du trépied partent deux éléments décoratifs supplémentaires : ce sont à nouveau deux objets liturgiques ; à gauche à nouveau une branche de palmier dont il faut rappeler l’usage lors de la fête des cabanes ; à droite une corne de bélier, le shofar, destiné à l’usage synagogal des deux premières fêtes d’automne.
Je ne puis parler qu’avec beaucoup de discrétion du dernier objet et qui nous ramène vers la vallée du Rhône, plus exactement dans celle de son affluent, la Durance.
La lampe que voici (fig. 7) a été découverte en 1967 par M. Henri Morestin sur la colline de Beau- regard à Orgon, au quartier de Vau.
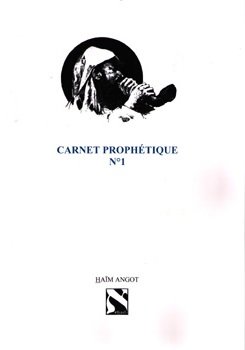 Elle se trouvait au fond d’une cabane gauloise avec des tessons divers et des ossements animaux.
Elle se trouvait au fond d’une cabane gauloise avec des tessons divers et des ossements animaux.
La discrétion m’est imposée par le fait que j’ai eu connaissance de cette lampe grâce toujours à mon enquête systématique signalée à l’instant. C’est ainsi que M. André Dumoulin, Conservateur des Monuments historiques et des Musées de Cavaillon, m’a fait connaître cette lampe qui fait désormais partie de ses collections.
Mais il est bien normal que M. Morestin, l’inventeur de la pièce, garde l’avantage de sa publication circonstanciée. Nous avons affaire ici à l’objet le plus ancien de notre série.
Le Conservateur du Musée de Cavaillon propose comme date la seconde moitié du Ier siècle avant l’ère commune.
Il est vrai que le bec à tête d’enclume, les deux ailerons latéraux qui sont des appendices de préhension ou de suspension, que tout ceci permet de ranger cette lampe à une si haute époque. Mais il est également vrai que si nous voulons y reconnaître une représentation du chandelier à sept branches, nous devons sensiblement rajeunir cet objet.
En effet, Goodenough, que j’ai déjà eu l’occasion de nommer et qui a étudié des centaines de documents qui comportent le chandelier à sept branches, est tout à fait formel : le chandelier n’apparaît sur aucune œuvre antérieure à la destruction du Temple.
Je proposerais donc de fixer la date de cette lampe au plus tôt au dernier tiers du Ier siècle de notre ère.
D’ailleurs, ce n’est pas un seul chandelier que nous trouvons inscrit sur le disque central, mais deux chandeliers opposés, l’inférieur assurant quelque peu la fonction du trépied traditionnel.
Les branches assez fines se terminent par des espèces de petites boules ; ce procédé se retrouve assez souvent sur d’autres chandeliers et est destiné à signifier le chandelier allumé. Entre les deux chandeliers opposés, se trouvent de chaque côté quelques courtes tiges qui se terminent également en petites boules ; je serais tenté d’y voir des grains de raisin.
Arrivé ainsi au terme de notre rapide inventaire des témoignages archéologiques d’une présence juive en France du Ier au début du Ve siècle, il convient de rappeler la répartition géographique de ces implantations :nous avons d’une part le Sud-Est, plus exactement la basse vallée du Rhône avec Bagnols-sur-Cèze, Avignon et Orgon ; et d’autre part le Sud-Ouest avec Salignac-de-Pons et Bordeaux.
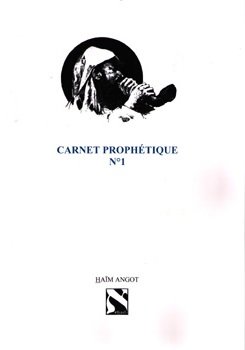 Si tout à l’heure j’ai fait bon marché des témoignages littéraires tardifs sur les premières implantations des Juifs en France, il convient peut-être désormais de leur accorder davantage de valeur.
Si tout à l’heure j’ai fait bon marché des témoignages littéraires tardifs sur les premières implantations des Juifs en France, il convient peut-être désormais de leur accorder davantage de valeur.
Ceci étant, j’aimerais même leur adjoindre une source juive du Moyen Âge qui de son côté relate les premières implantations des Juifs en France.
Ce récit légendaire qui est attesté au plus tard à partir du XIIIe siècle veut expliquer les circonstances dans lesquelles une pièce liturgique, la prière we-hu rahum, aurait été créée.
La légende raconte qu’au lendemain de la prise de Jérusalem le conquérant romain aurait rempli trois bateaux de captifs juifs. Partis sans capitaine ni équipage, ces bateaux auraient été poussés par le vent à travers la mer pour accoster l’un à Bordeaux, le second à Arles et le troisième à Lyon.
Tout en faisant la part des maladresses de l’auteur anonyme de cette légende qui transforme Arles et surtout Lyon en ports de mer, on retiendra son intention de placer les premières implantations juives en France d’une part dans le Sud-Ouest, et d’autre part dans le Sud-Est, le long du Rhône.
En projetant sur une carte de France l’ensemble de ces données (fig. 8) : les premiers lieux d’implantation juive selon la légende et les premières implantations prouvées par les découvertes archéologiques, nous trouvons une convergence qui mérite d’être signalée.
Mais relevons également, en guise de conclusion, pour tous ces objets enfouis dans le sol de France entre le Ier et le début du Ve siècle, un élément de convergence rare : malgré leurs fonctions si différentes, ils retrouvent leur unité profonde grâce au chandelier du Temple, la Menorah qui, dès cette époque, est l’emblème juif par excellence.
…
M. Henri Marrou s’associe aux félicitations et aux éloges que M. Courcelle vient d’adresser à M. Blumenkranz dont il a suivi avec intérêt les travaux et les progrès depuis près de vingt-cinq ans :
« L’amitié m’autorise cependant à vous mettre en garde contre un excès de subtilité : il me paraît difficile d’accepter l’interprétation proposée pour cette matrice. Ayant eu l’occasion d’étudier — en vue de la refonte du Recueil de Le Blant — la collection épigraphique et les manuscrits du docteur Esprit Calvet, j’ai pu constater que les antiquités rassemblées par celui-ci à la fin du XVIIIe siècle ne sont pas d’origine « locale » à proprement parler mais d’une origine « régionale », d’Arles à Vienne en passant par Vaison.
Il est peu probable que cette pièce provienne d’Avignon même, qui a peu fourni : c’est une ville du XIVe siècle, la cité des Papes a recouvert et nous dérobe le niveau antique. Il est bien imprudent de lire ici le nom abrégé d’Avignon ; j’imaginerais plus volontiers une erreur de gravure ou d’ordination qui aurait interverti les voyelles : ianv pour ivna qui serait un contre- épel, comme on en rencontre si souvent dans les inscriptions tardives, du nom de lona, tout à fait normal en milieu juif. »
MM. Pierre Courcelle, Louis Robert, André Parrot et Michel Lejeun
L’histoire des Juifs en France, ou sur le territoire lui correspondant actuellement, semble remonter au Ier siècle de l’ère commune et se poursuit jusqu’à nos jours, ce qui en fait l’une des plus anciennes communautés juives d’Europe occidentale.
 Lampe à huile d’Orgon (Ier siècle), le plus vieil artefact juif connu en France
Lampe à huile d’Orgon (Ier siècle), le plus vieil artefact juif connu en France
Arrivés en Gaule peu après sa conquête par Rome, les Juifs s’y maintiennent sous les Mérovingiens et connaissent une période de prospérité sous les Carolingiens. Au XIe siècle, la France devient un pôle florissant de la culture juive, abritant dans la moitié nord les communautés ashkénazes parmi lesquelles fleurit en Champagne l’école de Rachi et de ses continuateurs, et, au sud, les Juifs de Provence et du Languedoc.
La situation se détériore fortement après les Croisades auxquelles font suite les procès du Talmud et les expulsions, temporaires puis définitives. Un millénaire après leur établissement, il ne reste plus de Juifs dans le royaume de France. Seuls subsistent alors comme communautés importantes, hors les frontières du royaume, les Juifs des États papaux et les Juifs alsaciens. (Wikipedia)
Et certains disent que le peuple juif n’existe pas….!
Photo de présentation : Inscription funéraire de Narbonne (689)
Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité, de citer le site: http://www.terrepromise.fr
Copyright Terre Promise © Elishean/2009-2015/Terre Promise


